Dernier essai le
- Score :
/20
Introduction
Introduction
La carte scolaire établit chaque année un découpage en secteurs des départements et des villes en fonction du nombre prévisionnel d'élèves. Chaque établissement appartient à un secteur géographique : tout élève doit être scolarisé dans l'école primaire ou le collège du secteur où sa famille est domiciliée. Créée en 1963, l'objectif était de répartir efficacement les élèves et les enseignants. Le débat sur la carte scolaire est ancien et récurrent : nous posons ici quelques points de repères.
 |
La carte scolaire : deux réalités
La carte scolaire : deux réalités
La carte scolaire est une expression qui recouvre deux réalités différentes :
- la « carte scolaire » est l'opération annuelle par laquelle l'inspection académique répartit les moyens disponibles en postes et en classes dans toutes les écoles ou communes, pour la rentrée. Dans le primaire, la « sectorisation » désigne le rattachement des enfants à telle ou telle école au plus près de leur domicile, elle dépend de la commune(1).
- la « carte scolaire » est l'obligation faite aux parents de scolariser leur(s) enfants (s) dans l'école, le collège ou lycée de leur lieu de résidence. Cette règle pour laquelle existaient déjà des dérogations dans le secondaire a été sensiblement assouplie depuis 2007 pour disparaître à la rentrée 2010.
La carte scolaire : 1963-2007
La carte scolaire : 1963-2007
1963
La carte scolaire a été mise en place en 1963, et désigne un système d'affectation des élèves dans une école, un collège ou un lycée situé dans un secteur géographique où ces élèves sont domiciliés. Ce processus de répartition a été créé par Christian Fouchet, ministre de l'Éducation nationale. Il s'articule autour de deux paramètres : la répartition géographique des postes d'enseignants et la répartition des élèves en secteurs d'affectation.
Or, dans les années 1960, une période de forte construction d'établissements scolaires, cette carte scolaire avait pour objet une meilleure répartition des élèves en fonction des établissements et des moyens d'enseignement. Autrement dit, à son origine elle n'est pas liée à d'autres préoccupations que celle de la massification de la population scolaire.
Pour la contourner, un processus qui a commencé dans au début des années 1980, (à la suite des conséquences de la réforme « Haby(2) »), il était nécessaire de demander une dérogation à l'inspecteur d'académie. Les motifs de dérogation étaient limités :
- Obligations professionnelles des parents
- Raisons médicales
- Continuation de la scolarité dans le même établissement après un déménagement
- Inscription dans un établissement de la ville où un frère ou une sœur est déjà scolarisé
Certaines familles recouraient à des « astuces » pour obtenir l'intégration dans l'établissement souhaité : fausse domiciliation chez un parent qui habite sur la zone d'affectation, voire achat d'un logement sur la zone d'affectation de l'établissement voulu, choix d'une option rare (russe première langue, ou chinois par exemple). Régulièrement contournée, elle n'assurait plus l'égalité des chances et ne répondait plus aux attentes des familles.
« Gérer la France de 2007 avec les outils de 1963, voilà la réalité de la carte scolaire(3) »
Juin 2007
Première décision : la note ministérielle du 4 juin 2007, sans changer le cadre général, donne alors deux objectifs nouveaux à la procédure :- « donner une nouvelle liberté aux familles »,
- « à terme, leur donner le libre choix de l'établissement scolaire pour leurs enfants. »
La suppression de la carte scolaire
La suppression de la carte scolaire
En vigueur depuis la rentrée 2007, la suppression s'est effectuée de manière progressive.
Dès le mois de septembre 2007, davantage d'élèves ont pu s'inscrire dans un établissement hors de leur secteur, dans la limite des places disponibles. C'est une liberté nouvelle donnée aux familles qui doit renforcer la diversité sociale et géographique au niveau de chaque établissement. Pour autant, cet assouplissement ne modifie en rien le droit pour les parents d'inscrire leurs enfants dans l'établissement de leur secteur.
Chiffres
À la rentrée 2007, 13 500 nouvelles demandes ont été déposées, dont 2 500 en région parisienne. Un tiers de ces demandes concernait l'entrée en 6e, deux tiers l'entrée au lycée. 77 % des demandes ont été satisfaites au niveau du collège et 67 % au niveau du lycée. L'assouplissement de la carte scolaire a favorisé une plus grande diversité sociale(4).En décembre 2007, Xavier Darcos confirme la suppression de la carte scolaire. Il argumente cette décision par la réussite des expériences d'assouplissement menées au début de la rentrée 2007, qui ont permis d'augmenter la satisfaction des parents. La mesure est donc mise progressivement en place.
Dans la circulaire du 21 mai 2009, le processus s'affirme dans le second degré :
« L'assouplissement de la carte scolaire participe d'une volonté de renforcement de l'égalité des chances entre les élèves, mais aussi de la diversité sociale au sein des établissements. Elle répond à une volonté de transparence en matière d'affectation dérogatoire. À cet égard, l'intérêt de cette mesure n'est effectif que si les familles les moins favorisées s'approprient cette possibilité nouvelle. Les familles des élèves concernés par les critères prioritaires sont informées des possibilités qui leur sont offertes. Ces critères demeurent inchangés par rapport aux rentrées 2007 et 2008. »
« L'assouplissement de la carte scolaire participe d'une volonté de renforcement de l'égalité des chances entre les élèves, mais aussi de la diversité sociale au sein des établissements. Elle répond à une volonté de transparence en matière d'affectation dérogatoire. À cet égard, l'intérêt de cette mesure n'est effectif que si les familles les moins favorisées s'approprient cette possibilité nouvelle. Les familles des élèves concernés par les critères prioritaires sont informées des possibilités qui leur sont offertes. Ces critères demeurent inchangés par rapport aux rentrées 2007 et 2008. »
La carte scolaire sera supprimée, pour les collèges et les lycées, à la rentrée 2010. Un régime d'assouplissement a été mis en place pour inscrire progressivement cette suppression(5).
Par conséquent, depuis la rentrée 2007, un plus grand nombre d'élèves peuvent s'inscrire dans un établissement hors de leur secteur, dans la limite des places disponibles. Parallèlement, il est demandé aux établissements scolaires de veiller à une grande diversité sociale et géographique de leurs recrutements.
Textes de référence
Article D211-10 du Code de l'éducation
« Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques. Les districts scolaires correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique. »Article D211-11 du Code de l'éducation
« Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par l'inspecteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable de l'inspecteur d'académie du département de résidence. »
La carte scolaire : des avis partagés
La carte scolaire : des avis partagés
Le rapport Obin : un premier constat
Pour MM. Obin et Peyroux(6), le principal effet de l'assouplissement de la carte scolaire a été de dégrader davantage la mixité scolaire : « L'assouplissement de la carte scolaire a agi comme un effet de loupe sur l'image et le pilotage des établissements des quartiers dévalorisés (…) Elle a produit une accélération des processus sociaux à l'œuvre depuis de nombreuses années qui sont en partie responsables de la baisse inexorable des élèves…. »
Pour ces deux inspecteurs généraux, les établissements déjà délaissés sont les plus touchés par cette érosion. « Dans la plupart des départements visités, la question de la survie de certains collèges est ouvertement posée (…). C'est aux deux extrémités de la hiérarchie des établissements que la mixité sociale est mise le plus rudement à l'épreuve : dans les établissements les plus convoités, il y a peu d'élèves de condition modeste ; dans les collèges les plus évités, ce sont les catégories favorisées qui ont disparu. »
La création d'options ou de filières d'excellence dans les quartiers sensibles, les labels ZEP et « ambition réussite » n'y change rien : « Non pas qu'il faille se contenter d'une offre médiocre dans ces collèges (…), mais jamais ces initiatives ne permettent de faire revenir les populations des classes moyennes qui ont déserté un établissement. »
Cependant il n'en demeure pas moins, selon eux, que concilier une plus grande liberté des familles et une plus grande mixité des établissements est « possible. » Jean-Pierre Obin et Christian Peyroux souhaitent pour les familles le maintien d'un « droit d'affectation dans l'établissement le plus proche du domicile » et une régulation toujours « assurée par l'État » plutôt que par les chefs d'établissement ou les parents eux-mêmes. Ces propositions trouveraient un écho plutôt favorable au ministère de l'éducation nationale.
Enfin, pour créer une dynamique de mixité, ils suggèrent en outre l'introduction d'un « indicateur » de suivi de la mixité sociale : cet indicateur permettrait de récompenser les établissements les plus vertueux par une « dotation supplémentaire. »
Agnès van Zanten : des exemples en Europe
« Le dispositif mis en place par Xavier Darcos à la rentrée 2007 se situe dans la continuité des expériences antérieures d'assouplissement en produisant les mêmes effets mais avec deux changements majeurs. Le premier s'est traduit par une augmentation sensible des demandes de dérogation et surtout de leur taux de satisfaction par les autorités locales, accentuant la fuite des établissements les moins réputés et renforçant les déséquilibres démographiques et les ségrégations. Le second est l'importance nouvelle accordée au critère de « boursier ». Cette mesure pourrait se rapprocher des systèmes de quotas mis en place au nom de l'équité dans certains systèmes scolaires. (…) Mais ce critère n'a pas été appliqué de façon systématique. Surtout, il accentue le problème des inégalités entre établissements. En effet, les boursiers qui bénéficient de l'assouplissement de la carte sont essentiellement de bons élèves. Il peut paraître juste à l'échelle individuelle que leurs efforts ne soient pas entravés par les caractéristiques de leur environnement scolaire. Pourtant, leur départ a des conséquences négatives pour les établissements dont ils sont issus. Ce critère ne suffit donc pas à limiter les effets pervers du libre choix. Il est nécessaire de développer d'autres moyens de régulation(7) » (…) »
« Parallèlement, la question financière est aussi un obstacle. Changer de collège, c'est aller dans un établissement plus éloigné, ce qui entraîne un coût de transport supplémentaire, mais aussi des frais de cantines, puisque l'élève ne peut plus rentrer chez lui le midi. Enfin, des facteurs psychologiques peuvent intervenir. Certaines familles, notamment immigrées, considèrent que la proximité de leurs enfants est un élément important pour contrôler leur éducation. Les laisser dans un établissement plus éloigné leur donne l'impression de perdre cette maîtrise »(8).
Spécialiste de l'éducation, Agnès van Zanten indique qu'il existe à l'étranger, des exemples intéressants. Londres mène ainsi une politique de « quotas » : dans chaque établissement, il est prévu de scolariser un tiers de bons élèves, un tiers de moyens et un tiers de mauvais. L'exemple belge est aussi intéressant : les chefs d'établissement d'une même région se mettent d'accord entre eux pour qu'aucun établissement ne soit lésé.
Le rapport de la Cour des comptes
Dans son rapport(9), la Cour évoque notamment l'impact défavorable de l'assouplissement de la carte scolaire. En 2008, les demandes de dérogation ont augmenté de 29 % et certains collèges ont enregistré des pertes d'effectifs pouvant aller jusqu'à 10 %, tandis que d'autres connaissaient des progressions allant jusqu'à 23 %. Plus particulièrement, 186 des 254 collèges « ambition réussite » (établissements les plus en difficulté du système d'éducation prioritaire bénéficiant de ce fait de dispositifs éducatifs particuliers) ont perdu des élèves. Dans ces établissements, la baisse des effectifs s'est traduite par une plus grande concentration des facteurs d'inégalités contre lesquels doit lutter la politique d'éducation prioritaire…
Ces différents points de vue étant posés, il n'en demeure pas moins que la disparition de la carte scolaire va permettre aux parents de choisir l'établissement scolaire de leurs enfants.
Dossier réalisé par Frédérique Thomas, professeur agrégée, docteur en STAPS,
Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.
Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.
À lire
À lire
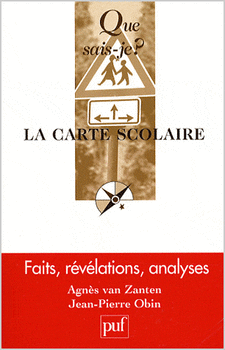 |
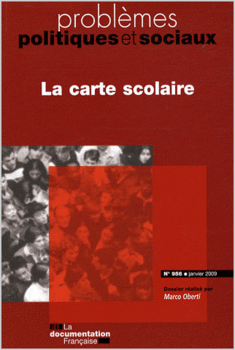 |
